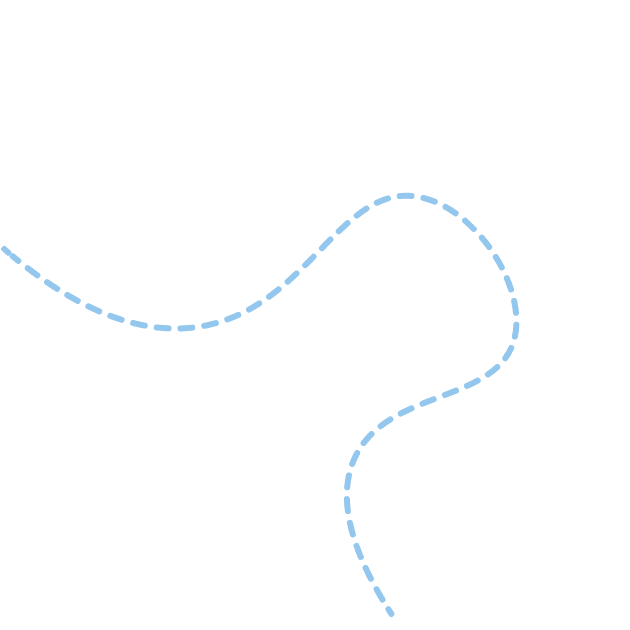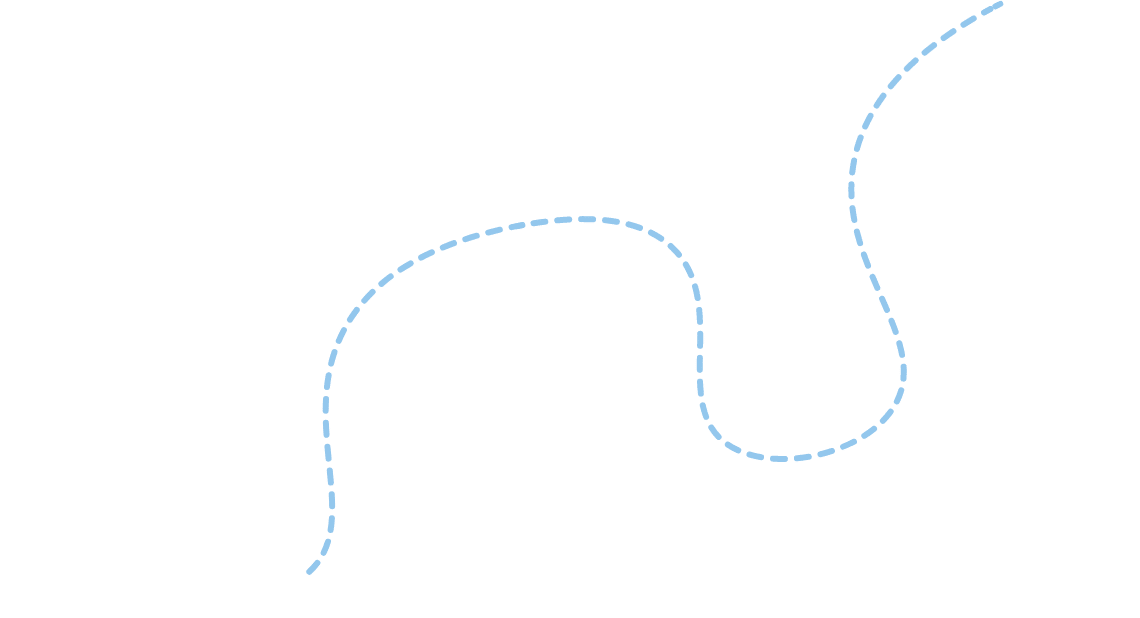Créé le 25 septembre 2017, modifié le 24 janvier 2020
Contexte lié à l'outil
« Les démarches d’évaluation et d’amélioration ont pour objectif d’améliorer la qualité de prise en charge des patients en recherchant la meilleure adéquation entre la pratique réelle et la pratique de référence. Celle-ci étant définie, à chaque fois que possible, à partir des données de la science, en l’absence de ces données à partir d’un accord professionnel. L’utilisation pratique des recommandations pour améliorer la pratique professionnelle nécessite l’utilisation de méthodes, qui permettent de les décliner à un niveau opérationnel et de mesurer leur mise en œuvre. Le choix de la méthode est fonction de l’activité, de l’organisation, de l’expérience, de la culture d’évaluation développé dans l’équipe ou l’établissement ainsi que de l’état de la science et des outils disponibles. » HAS ; 2004
Objectif(s)
La revue de pertinence des journées d’hospitalisation est une méthode d’amélioration de la qualité qui permet de repérer les journées non pertinentes, de rechercher les causes qui expliquent ces journées et de mettre en place des plans d’action pour améliorer la prise en charge du patient.
Elle s’effectue à l’aide d’une grille de critères AEPf développée en 2004 par la Haute Autorité de santé (HAS) pour les filières MCO (médecine, chirurgie, obstétrique).
Depuis 2012, une grille validée (1-2) de revue de pertinence des journées d’hospitalisation en soins de suite et réadaptation (SSR) est mise à disposition des établissements de la région Pays de la Loire sur la plateforme eFORAP de QualiREL Santé.
Cependant, dans certains services, pour certaines pathologies ou pour la prise en charge de populations spécifiques, l’adaptation des grilles peut s’avérer nécessaire. Ces différents cas nécessitent d’élaborer de nouveaux critères afin de répondre au périmètre concerné et ceci selon une méthodologie validée. QualiREL Santé impulse notamment cette réflexion sur l’adaptation à la filière de médecine gériatrique.
Modalités de création
Revue de pertinence des admissions en MCO
Revue de pertinence des journées d’hospitalisation en MCO
Revue de pertinences des journées d’hospitalisation en SSR
Suite à une forte demande des établissements de SSR de développer des travaux spécifique à ce secteur, un projet intitulé IPC-SSR (Indicateur de performance clinique en SSR) a été mené par QualiREL Santé. C’est donc dans ce cadre qu’un comité d’organisation ainsi qu’un groupe de travail composé d’experts des disciplines concernés a été mis en place.
Selon une méthodologie dérivée du concensus formalisé d’experts développé par la HAS, une grille de 16 critères de pertinence des journées d’hospitalisation en SSR a été créée puis validée en 2009. L’outil est disponible sur la plateforme eFORAP pour la saisie et l’analyse des données. Les documents sont téléchargeables ci-dessous.
Une synthèse est réalisée tous les ans pour la région des Pays de la Loire. Celle-ci compile les résultats issus des nouvelles saisies en regard des précédentes années. Retrouvez la synthèse 2017-2018 en téléchargement PDF : Synthèse 2017-2018.
Modalités d'utilisation
Les outils sont disponible sur la plateforme eFORAP.
Liste des fichiers à télécharger
-
Grille de pertinence des journées d'hospitalisation SSR
-
Guide d'utilisation Revue de Pertinence
-
Synthèse des campagnes d'évaluation 2017-2018
Modifié le 31 mars 2025
Contenu
- Faciliter l’appropriation des attendus des éléments d’évaluation de chaque critère impératif
- Présenter une vision globale des attendus du manuel de certification en analysant les attendus des critères associés à un critère impératif.
Que trouve-t-on dans une fiche mémo ?
- En préambule, le critère impératif et la liste des critères en lien avec la thématique
- Le critère impératif, ses objectifs et ses attendus, et les éléments d’évaluation complétés par le regard de la FORAP
- Les critères en lien avec la thématique, complétés par le regard de la FORAP
- Des annexes composées de ressources, de références bibliographiques et d’outils développés par la FORAP sur la thématique