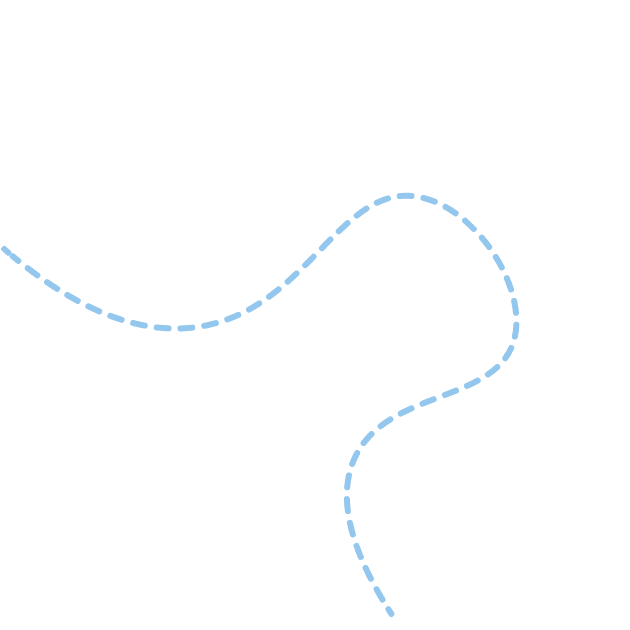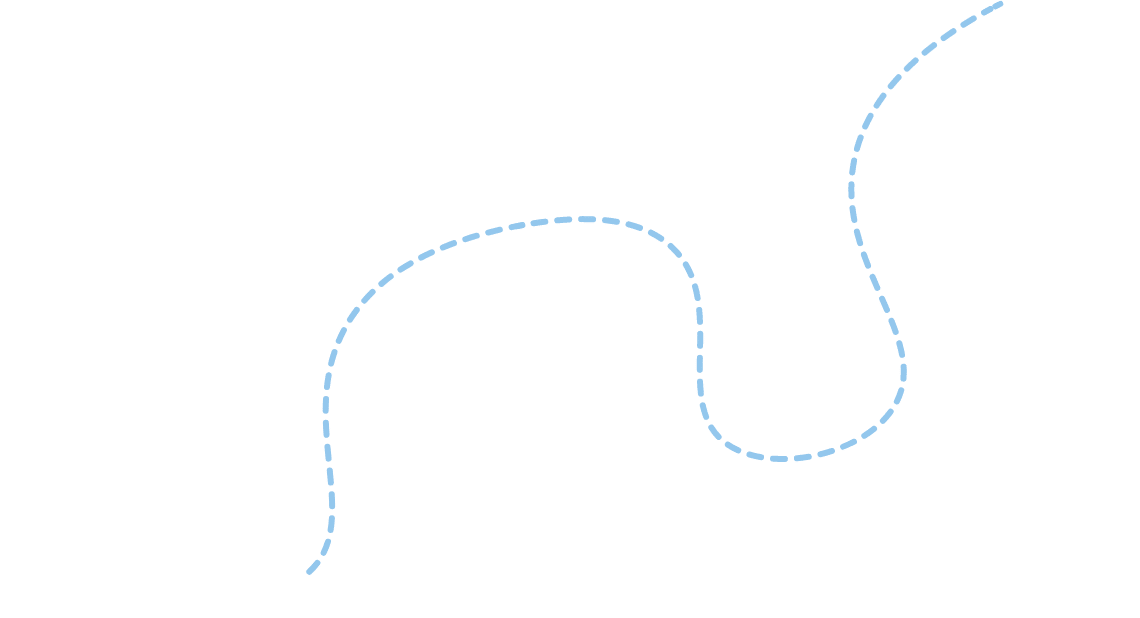Créé le 29 septembre 2017, modifié le 27/03/2025
Contexte
Né au milieu des années 90 dans le secteur de la petite enfance, le terme de bientraitance est rapidement repris dans l’ensemble du secteur médico-social, qui travaille depuis plusieurs années sur les questions de maltraitance, notamment en institution. En 2008, l’ANESM publie une recommandation sur la thématique de la bientraitance.
Dans le champ sanitaire, le terme de bientraitance est repris par la HAS qui, suite à la publication du rapport sur la prévention de la maltraitance ordinaire, a inscrit la promotion de la bientraitance dans les critères de la certification des établissements de santé.
C’est dans ce contexte que la FORAP et l’HAS ont décidé de mettre en place un groupe de travail sur cette thématique. Afin, de mutualiser les travaux sur la promotion de la bientraitance au niveau national (pour plus d’informations : http://www.forap.fr/pdf/Forap-HAS-bientraitance_-_rapport.pdf).
Objectif(s)
La FORAP![]() et la
et la  HAS proposent un guide dont l’objectif est d’accompagner les établissements dans le déploiement de la bientraitance en leur donnant les outils stratégiques et opérationnels nécessaires. Outre une démarche de déploiement d’une politique de bientraitance, le groupe propose un kit de 7 outils aux établissements. Ces derniers peuvent les utiliser et les adapter en fonction de leur situation, de leur degré de développement préalable de la bientraitance, de leurs objectifs et de leurs besoins. Un dossier complet est consacré à ce thème sur le site de la HAS.
HAS proposent un guide dont l’objectif est d’accompagner les établissements dans le déploiement de la bientraitance en leur donnant les outils stratégiques et opérationnels nécessaires. Outre une démarche de déploiement d’une politique de bientraitance, le groupe propose un kit de 7 outils aux établissements. Ces derniers peuvent les utiliser et les adapter en fonction de leur situation, de leur degré de développement préalable de la bientraitance, de leurs objectifs et de leurs besoins. Un dossier complet est consacré à ce thème sur le site de la HAS.
Auquel, nous avons joints d’autres supports qui peuvent être utilisé dans le cadre de la promotion de la Bientraitance dans votre établissement.
Description
Vous avez participé ou non à la formation «Sensibilisation à la démarche éthique et promotion de la bientraitance», vous trouverez en pièces jointes dans les onglets ci-dessous, un panel d’outils de promotion de la bientraitance que vous pouvez utiliser dans votre établissement (liste non exhaustive) :
| Outils
Etat des lieux |
Outils
Animation d’équipe |
Outils
Valeurs |
Outils
Sensibilisation/formation |
|---|---|---|---|
| 1.Outil d’auto-évaluation du REQUA | 6. Outil d’animation des équipes – mises en situation du CCECQA | 8. Charte de promotion de la bientraitance du RBNSQ | 9.Outil d’auto-évaluation du CEPPRAL |
| 2. Regards croisés sur la Bientraitance V3 | 7. Diaporama en dialyse | 10. Outil d’aide à la décision – formation Bientraitance QualiREL Santé | |
| 3. Cartographie des risques du RSQ | |||
| 4. Micro-Interview Usagers CISS-RQS | |||
| 5. Expérience patient : Amppati |
D’autres outils existent, notamment :
– Un jeu de l’Oie (Outil d’animation équipe) réalisé par le réseau Requa, vous pouvez vous procurer ce jeu en contactant directement le Requa par mail requa@requa.fr ou Tél. 03.81.61.68.10.
– La malette Mobiqual Bientraitance (outil de sensibilisation/ Formation)
D’autres documentations sont disponibles sur le site internet de l’HAS :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_915130/fr/promotion-de-la-bientraitance